Les coulisses du journalisme burundais racontées par les professionnel.le.s
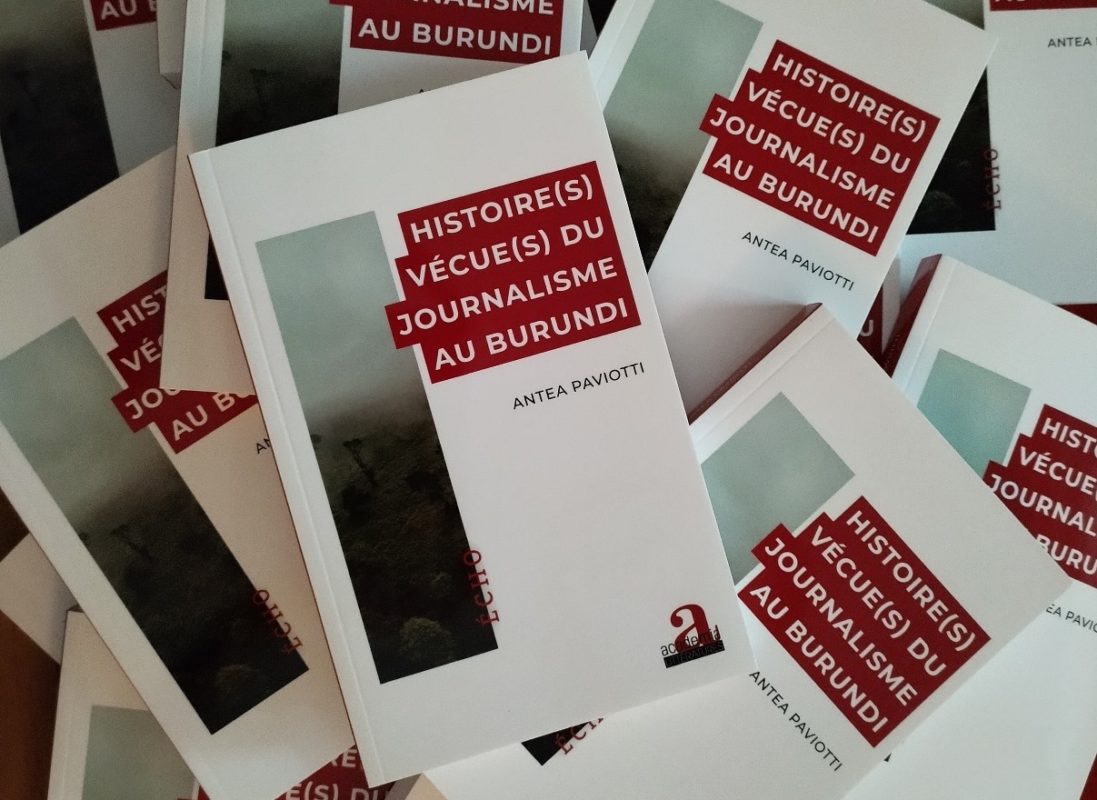
Dans son dernier livre « Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi », paru en septembre, l’anthropologue et écrivaine Antea Paviotti nous amène à la découverte de ce métier souvent opprimé par des pouvoirs autoritaires. Sur 226 pages, l’autrice nous dévoile le visage de ce monde par l’intermédiaire de 16 journalistes qui racontent leurs expériences. Nous nous sommes plongés dans ce livre passionnant et avons rencontré l’autrice.
« Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi » est une compilation de 16 témoignages d’histoires personnelles de journalistes Burundais. À travers leurs expériences, ces professionnel.le.s des médias mettent la lumière sur la réalité à laquelle on fait face dans l’exercice de ce métier au Burundi.
L’autrice, Antea Paviotti, tend le micro et écrit. Il ne s’agit pas d’un roman fictif. C’est un livre, résultat de rencontres physiques et d’échanges, qui lève le voile sur les cinq dernières décennies du journalisme dans une société si souvent frappée par des crises sociopolitiques. Oui, cette chercheuse passionnée de récits de vie a croisé les personnages dont elle transcrit les récits sur sa route lors de la recherche qui l’a menée jusqu’au Burundi.
Dans ce livre, les ancien.ne.s journalistes et ceux/celles en exercice interviewé.e.s racontent directement leurs expériences personnelles. Ils relatent les coulisses des salles de rédaction, entrouvrent cette porte « interdite aux personnes étrangères ».
Les seize récits d’expérience personnelle dans le journalisme laissent les lectrices et lecteurs curieux de découvrir l’interstice entre le monde médiatique et la sphère politique. Certain.e.s nous emmènent avec eux/elles loin, au désert de l’exil, ou sur le terrain, dans leurs reportages. D’autres nous font découvrir la pression officieuse derrière les bureaux, et la déception qu’on ressent quand on n’a pas la liberté de défendre la liberté des autres. C’est là la vraie galère de ce métier. Mais, dans ces témoignages racontés à la première personne, on découvre aussi le courage, la résilience du/de la professionnel.le qui s’efforce toujours à faire encore mieux.

« Je voudrais que chaque lectrice et lecteur lise les mots des journalistes et tire ses conclusions, sans que j’impose les miennes. »
En lisant ces histoires rapportées à la première personne, les lectrices et lecteurs se sentent en contact direct avec la personne qui témoigne. Même si l’autrice s’efface dans le texte, on dirait qu’on l’entend chuchoter à ses interviewé.e.s : « Prends le micro, raconte-nous !».
Selon Antea Paviotti, cette approche permet de garder la fraîcheur et l’authenticité des récits. « Je n’ai pas voulu ajouter de commentaires pour ne pas déformer les récits. En plus, je ne voulais pas adopter une approche analytique. Je voudrais que chaque lectrice et lecteur lise les mots des journalistes et tire ses conclusions, sans que j’impose les miennes », explique-t-elle, interrogée sur le choix de cette approche.
Témoignages bruts et diversité
Dans sa méthodologie, un autre point retient l’attention : la diversité. Les personnes interrogées ne sont pas choisies par hasard. Des plus anciens aux plus jeunes journalistes, l’histoire du journalisme au Burundi retrace l’image de ce métier de la jeunesse des premiers médias au Burundi jusqu’aujourd’hui.
Les journalistes qui partagent leur expérience professionnelle ne se différencient pas seulement par leur âge. L’autrice a pris soin de les choisir compte tenu de leurs groupes sociaux d’appartenance : Ganwa, Hutu, Tutsi, hommes et femmes. Elle a pris également soin d’interroger les journalistes exilé.e.s en Belgique et ceux/celles vivant au pays, ceux/celles du secteur public et du privé.
« Seules l’écoute et la considération de l’ensemble de ces narrations (…) peuvent conduire à la « vraie » vérité, qui ne pourra qu’être composée par la pluralité de toutes les vérités existantes. »
Pour l’anthropologue, il fallait prendre en compte la diversité de la société burundaise. « J’ai voulu éviter qu’il y ait une partie qui se sentirait laissée. » Elle affirme par exemple que les journalistes en exil peuvent ne pas avoir les mêmes points de vue sur les faits historiques que ceux/celles resté.e.s au pays. De même, les personnes issues de différents groupes sociaux pourraient avoir des points de vue divergents. « Seules l’écoute et la considération de l’ensemble de ces narrations et vérités, qui ont toutes le droit, voire le devoir, d’exister, peuvent conduire à la « vraie » vérité, qui ne pourra qu’être composée par la pluralité de toutes les vérités existantes », explique-t-elle dans les conclusions du livre.
La résilience des journalistes
Le livre, à travers ces témoignages, montre que le journalisme burundais a toujours fait face à des difficultés liées à la répression de la liberté d’expression. Plusieurs anecdotes racontées par les anciens journalistes permettent de comprendre à quoi ressemblent les méandres de ce métier dans un pays où la démocratie se cherche encore.
Dans son exercice en tant que directeur à la radio nationale dans les années 1980, par exemple, Simon Kururu raconte comment il a à plusieurs reprises résisté aux autorités qui voulaient utiliser la radio à des fins purement politiques. Dans les années 1970, le gouvernement de Bagaza, qui était en conflit à la fois avec les pays limitrophes et avec l’Église catholique, faisait sans cesse pression sur la radio nationale. Kururu s’en souvient. « En tant que directeur de la radio, j’ai été confronté à plusieurs situations où j’étais vraiment en danger », indique cet ancien responsable à la radio nationale. Epuisé, ce journaliste qui affirme avoir bénéficié du crédit du président de la République décidera de remettre son tablier pour se construire une nouvelle vie dans la profession libérale.
Alexis Sinduhije nous fait part de sa surprise à son arrivée dans les studios de la radio mère des médias du Burundi comme jeune journaliste dans les années 1990. « Dès mon arrivée à la RTNB, j’ai compris qu’il y avait des informations qu’il ne fallait pas traiter : tout ce qui pouvait s’opposer au parti UPRONA et au gouvernement en place », confie l’ancien journaliste. Sinduhije affirme que le traitement des sujets qui touchent à la politique constituait un sacrilège.
« À ce moment-là, les gens devaient choisir leur camp. Nous, nous avions refusé de le faire pour choisir le camp de l’information. »
Après l’éclatement de la crise de 1993, il sera obligé de quitter la RTNB pour s’exiler au Rwanda en 1994. Il faisait face à des menaces de mort. « À ce moment-là, les gens devaient choisir leur camp. Nous, nous avions refusé de le faire pour choisir le camp de l’information », indique-t-il. Les publications de La Semaine, un journal indépendant qu’il avait co-fondé avec un ami en parallèle de son travail à la RTNB, lui attiraient les foudres d’un pouvoir militaire qui s’était installé après un coup d’Etat.
D’autres journalistes qui ont été des cadres à la RTNB, radio unique du pays pendant plusieurs années (jusqu’en 1995) et contrôlée par l’Exécutif, témoignent également sur les pressions auxquelles ils faisaient face. Karenga Ramadhan, Innocent Muhozi, Nestor Nkurunziza, Louis-Marie Nindorera, Valéry Muco manquaient souvent de liberté dans le traitement et la diffusion de l’information dans des situations où c’était plus que nécessaire. Ces journalistes racontent comment ils ont eu « le bras tordu » dans des situations critiques.
Malgré les difficultés, les témoignages montrent que les médias ont toujours essayé de contribuer à l’avancée de la société. Les différents récits reflètent cette volonté de bien faire dans des situations très tendues et d’une complexité inouïe.
Un long processus de réveil
« Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi » n’est pas qu’un simple roman narratif. Antea Paviotti a creusé dans une mine qui n’a pas connu beaucoup de pioches mais qui est assez riche. Le journalisme a toujours joué un rôle irremplaçable dans la vie sociopolitique au Burundi. Les chevaliers et chevalières de la plume et du micro ont croisé les évènements, accompagné des changements politiques majeurs, en payant parfois le prix fort.
« Je pense que ce livre pourra peut-être constituer une source d’inspiration pour les jeunes qui veulent découvrir ce métier. »
Cependant, peu d’écrits existent autour de ce métier fascinant, dont une étude rétrospective permettrait de comprendre davantage l’histoire d’une société qui peine à comprendre son passé. « J’ai constaté qu’il n’existe pas beaucoup de livres sur le journalisme vécu au Burundi, et je pense que ce livre pourra peut-être constituer une source d’inspiration pour les jeunes qui veulent découvrir ce métier », explique l’autrice.
Pour cette anthropologue, le livre pourrait aussi encourager d’autres personnes à écrire sur ce sujet. Les récits des journalistes interviewé.e.s dressent un tableau multicolore et riche d’informations sur un métier qui continue de passionner la jeunesse burundaise. « J’espère que leurs récits pourront offrir de nouvelles perspectives et ainsi enrichir les connaissances de celles et ceux qui ont étudié ou travaillé dans le journalisme burundais. J’espère aussi qu’ils pourront inviter des personnes non familières avec le Burundi ou avec le journalisme dans ce pays à en apprendre davantage », lit-on dans la partie conclusion du travail.
Casser la polarisation
D’un ton équilibré et avec des mots simples, le livre met indirectement la lumière sur l’engagement, la résilience et surtout la défense de la liberté de la presse incarnée par les professionnel.le.s des médias. Il souhaite aussi casser la polarisation du monde médiatique burundais, particulièrement visible après 2015.
Dans les dernières lignes, Antea Paviotti mentionne l’appréciation mutuelle qu’elle a pu entendre pendant les interviews entre quelques journalistes en exil et d’autres resté.e.s au pays. Pour elle, par une approche critique et prudente, en écoutant les histoires et vérités des un.e.s et des autres, on peut avancer vers la résolution effective des conflits, dans le journalisme comme dans la société.
Ainsi, ce livre pourrait constituer un des outils utiles à la consolidation de la cohésion sociale au Burundi.
Note : « Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi » (Editions Academia, Collection ECHO), 226 pages, 20,50€.
Le livre peut être commandé ici et d’autres récits ont été publiés sur le site web du projet.




