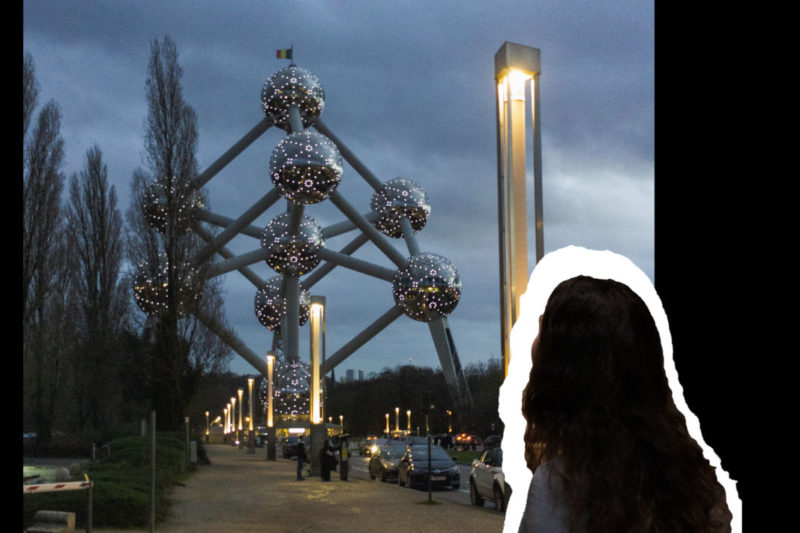Turquie, un an après le séisme : “Le plus important, c’est la vie en communauté” (2/3)

Le 6 février 2023, deux séismes majeurs ont frappé la Turquie et la Syrie. Un an après, Latitudes a parcouru Hatay, la province turque la plus touchée, pour faire un bilan de la situation au travers de portraits.
Yusuf est interne en médecine. Sevilay est professeure. Ils ne se connaissent pas, et pourtant, partagent un lien indélébile : tous deux ont choisi de rester à Antakya (Antioche) après le séisme du 6 février 2023. Alors que beaucoup ont fui, Sevilay et Yusuf sont déterminés à croire en leur ville. Par solidarité, ils continuent jour après jour de prendre soin de leurs patients et élèves. Portraits croisés de ceux qui construisent leur vie dans une ville en ruines.
Yusuf : “On a fait du mieux qu’on a pu”

Depuis un an, le quotidien de Yusuf est réglé comme du papier à musique. Rouler jusqu’à l’hôpital. Faire sa garde de vingt-sept heures. Quitter l’hôpital. Rentrer. Dormir. “Si j’ai de la chance, je travaille un jour ou deux dans la semaine, mais en général, c’est plutôt trois ou quatre.” L’étudiant est en dernière année de médecine à Antakya. À 24 ans, il en paraît dix de plus. Son visage n’est pas marqué, mais le tremblement de terre l’a “rendu adulte.”
En plus de ses cours, le jeune homme travaille à l’hôpital universitaire Mustafa Kemal, l’un des rares à encore fonctionner dans la région. Avant le séisme, ils étaient 217 internes, comme lui, à y travailler quotidiennement. Ils sont 60 aujourd’hui. Le nombre de patients, lui, a triplé pour atteindre en moyenne 600 par jour. Yusuf a bien essayé d’échapper à sa routine : quelques mois après le séisme, il va à Diyarbakır, sa ville natale dans l’est, mais Hatay le rattrape. “Je ne pouvais pas manger ou dormir. Je pensais à mes amis ici, qui souffrent pendant que moi, je suis au chaud. C’était trop difficile.” Alors, deux mois plus tard, il décide de rentrer. Pour aider.
Un campus vide
“Ici, pendant le séisme, c’était rempli de lits de camp”, désigne Yusuf de la main. Dans les couloirs vides de l’immeuble du campus de médecine, les pas résonnent. La table de ping-pong du grand hall attend ses joueurs. Ils ne sont plus beaucoup à étudier à Hatay. Sur 26.000 étudiants, l’université Mustafa Kemal en accueille encore 3.000, les étudiants des facultés médicales avec des cours appliqués. Ceux qui n’ont pas changé d’université assistent aux cours en distanciel depuis mars. Les campus des deux universités de la région ont subi des dégâts mineurs, mais requièrent des travaux de reconstruction, notamment pour les lieux d’hébergement des élèves. Les conditions de travail ne sont pas simples, témoigne Yusuf. “Dans notre département, on a perdu quinze professeurs et beaucoup d’autres ont quitté la région.” La plupart des enseignants restants sont mobilisés à l’hôpital pour pallier le manque de médecins.
“J’ai compris que la seule chose importante, c’est d’être en vie.”
Prendre du recul
Un an après, le traumatisme est toujours présent. “Il suffit de marcher dans la rue, qu’un camion arrive et avec le bruit, la vibration, le choc revient.” Comment s’en sortir, quand s’ajoute à cela un travail à temps plein et les examens finaux ? Yusuf avoue ne pas avoir trouvé la réponse. “Tous les jours, je me réveille, je fais les choses que j’ai à faire. Je survis juste.” Son métier d’interne l’épuise, mais le garde aussi en vie. L’étudiant tient avec cette idée fixe : “Quelqu’un doit aider les gens, alors ça sera moi.” Et puis, la catastrophe lui a appris à prendre du recul, à se dire que les examens et les cours sont des détails.“J’ai compris que la seule chose importante, c’est d’être en vie.”
Depuis un an, les conversations des étudiants en médecine ont changé. Ils ne parlent plus du futur, de leur plan de carrière ou de spécialités qu’ils devront bientôt choisir. Maintenant, on conjugue au présent. “On parle des tâches et des problèmes quotidiens, de la vie de tous les jours, parce qu’on sait que peut-être, dans dix minutes, il pourrait y avoir un séisme, et on pourrait tous mourir.” Eux qui étaient parfois prompts à la critique apprécient davantage leurs moments ensemble. Avec cette catastrophe, une nouvelle solidarité s’est créée.
Sevilay : “Lorsque je repense à ma vie en appartement, je me dis qu’il y a des choses que je préfère maintenant”

Sevilay finit de préparer le café dans la petite bouilloire de sa kitchenette. Les effluves se mêlent à ceux de la cigarette qu’elle vient d’allumer, jusqu’à embaumer la pièce de vie. Comme les trois quarts des habitants d’Hatay, la jeune femme vit maintenant en conteneur. Il y a tout juste sept mois, Sevilay quitte sa tente pour la boîte métallique. “Il était vide”, précise-t-elle. Pour personnaliser son nouveau “chez-soi”, elle y a ajouté ce qu’il restait de sa vie d’avant : quelques meubles, un radiateur électrique, un canapé et son chat Sonia. Dans le siège de camping posé près de la fenêtre, cette dernière s’endort. La chatte n’en a que faire du monde autour d’elle, contrairement à sa maîtresse, qui semble stressée à l’idée de parler d’elle. Son regard est fuyant lorsqu’elle s’assied sur le canapé.
Le conteneur provient d’une fondation étrangère qui en a installé une dizaine dans le quartier. “On a eu beaucoup de problèmes à cause de ça”, détaille Sevilay. “Les officiers sont venus et nous ont dit qu’il fallait partir. Ils ont essayé de nous faire peur.” Les installations considérées comme irrégulières par les autorités locales, ne sont pas du goût des ces dernières qui tentent de rassembler les habitants dans des camps officiels. Cette perspective n’enchante pas du tout Sevilay : “Je suis célibataire, donc on m’aurait mise avec une personne que je ne connais pas, dans un espace de 21 mètres carrés.” Ici, c’est aussi petit, mais au moins, elle a choisi sa colocataire, son amie Özlem qu’elle connaît depuis six ans. “Et puis, la ville-conteneur du gouvernement était vraiment loin du centre, sans arbre, sans vie sociale, ça faisait trop camp.”
Neuf écoles sur dix ont fermé
À 34 ans, Sevilay est professeure d’anglais depuis un peu plus d’une dizaine d’années. Chaque matin, dès 7h30, elle retrouve ses élèves. En parlant d’eux, son regard s’adoucit : “Ils sont très bavards, mais je les aime beaucoup.” Sevilay travaille à Antakya, dans l’un des derniers établissements de la région. Le bâtiment accueille désormais les élèves d’autres quartiers, qui n’ont plus d’endroits où poser leur cartable. Après le séisme, les adolescents ont dû attendre cinq mois avant de retourner sur les bancs de l’école. Des 265 établissements que comptait la ville, il n’en reste que 27. Plus des deux tiers des enseignants ont quitté Antakya et pour ceux qui sont restés, la situation n’est pas avantageuse : “Il n’y a aucune compensation financière, ce n’est pas normal.” À 13 heures, sa journée de travail se termine et l’après-midi est consacrée à son autre activité de syndicaliste. Avec d’autres professeurs de la région de Hatay, Sevilay parcourt la province à la rencontre de ses consœurs et confrères. L’objectif : évoquer les problèmes liés à leur profession et tenter de trouver un écho auprès des médias locaux.
À l’intérieur, le strict minimum
Sonia, le chat, se réveille, son sommeil probablement troublé par les discussions qui remplissent la pièce. Elle sort du salon et passe devant l’embrasure de la porte de la petite salle de bain. À l’intérieur, le strict minimum : douche, toilette, lavabo. Le tout est raccordé au réseau de la ville gratuitement, à l’instar de l’électricité. Plus intéressée par la perspective d’un assoupissement dans une couette confortable, Sonia jette son dévolu sur le lit d’Özlem, la colocataire de Sevilay. La petite chambre est coquette, un poster de rock des années 1970 sur le mur, deux matelas, bien assez pour un chat. Peut-être un peu restreint pour des humains.”Une fois, on a mis huit personnes dans le salon pour une soirée !”, se rappelle Sevilay en souriant. La pièce de dix mètres carrés n’est pourtant pas extensible, mais les deux colocataires mettent un point d’honneur à la rendre accueillante. “Lorsque je repense à ma vie en appartement, je me dis qu’il y a des choses que je préfère maintenant.”
Rapprocher les survivants
Pour Sevilay, “le plus important, c’est la vie en communauté” : les amis, les rencards, les soirées à papoter autour d’un thé. Ses amitiés sont récentes, surtout nouées avec des personnes qui vivent dans les conteneurs du quartier, mais elles sont fortes. Le tremblement de terre a rapproché les survivants : tout le monde a subi la même chose. Et puis, la vie en communauté les a rendus solidaires. Sur le camp, il y a un seul frigo pour la dizaine de conteneurs. Tout le monde n’a pas d’eau chaude, Sevilay doit prendre sa douche chez un ami. Mais pour elle, ce n’est pas une contrainte, juste un autre moment de partage. “J’avais un chauffe-eau chez mes parents, j’aurais pu l’installer, mais je préfère comme ça. Une douche, un thé et des discussions.”
Dans sa vie d’avant, Sevilay était souvent “dehors”, dans des cafés, des bars. Aujourd’hui, elle ne sort qu’une fois par semaine et passe beaucoup de temps chez elle. De cette vie-là, tout ne lui manque pas. “En appartement, je me sentais seule.” Pour se voir, il fallait s’appeler, s’organiser, prendre la voiture. “Maintenant, si je ne me sens pas bien, je peux être chez mon ami en quelques minutes, un thé chaud, des ragots et tout va mieux.”
Dans le prochain article, découvrez les portraits de Sadik et Doğuş, qui un an après le séisme, reconstruisent maison et commerce.
Retrouvez le premier article, sur la situation humanitaire et la vie en tente, ici.
Ce reportage a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.